Traduction et télévision : l’exemple d’Arte
La traduction et l’adaptation audiovisuelles sont des maillons d’une chaîne, celle qui permet de transposer une œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans une autre langue. Il s’agit parfois d’un processus de longue haleine, qui fait intervenir différents métiers. L’Écran traduit souhaite donner la parole à ces autres professionnels qui interviennent en amont ou en aval du travail des auteurs de sous-titrage, de doublage ou de voice-over. Dialogue entre deux traductrices et Anne-Laure Gougeon, Philippe Muller et Nadine Pellet-Zwick, chargés de programmes chez Arte GEIE, la centrale strasbourgeoise de la chaîne franco-allemande.
Comment êtes-vous entrés chez Arte et en quoi consistent vos missions respectives1?
Philippe Muller : Je suis rédacteur, chargé de programmes, pour les cases « Thema » et « Géopolitique ». Thema est une case de prime-time avec un film qui dure en général une heure et demie (ou deux fois 52 minutes). C’est une investigation documentaire, de plus en plus teintée de patte journalistique, généralement pas un film d’auteur. La case Géopolitique intervient en deuxième, voire troisième partie de soirée et est guidée par une ligne éditoriale extrêmement précise : de la géopolitique, du dossier, avec une orientation très internationale. Enfin, le troisième volet de mon activité, c’est le plateau. On a tous les mardis un plateau avec présentation et entretien.
J’ai démarré en Allemagne, où j’ai fait dix ans d’audiovisuel télé à Baden-Baden, comme chargé de programmes, auteur et réalisateur. Quand Arte est arrivée à éclosion, j’ai fait des pieds et des mains pour y entrer, ce qui m’a pris un ou deux ans. J’y suis depuis deux décennies.
J’ai aussi participé à la fondation d’une petite boîte de doublage et de sous-titrage en Allemagne. Des amis avaient des sous, moi j’avais une petite compétence, alors on a monté cette entreprise. J’étais assez à l’aise en allemand, mais pas au fait de la technique, j’ai dû tout apprendre. À Baden-Baden, on ne faisait pas de sous-titrage ni de doublage, on ne travaillait qu’en allemand. J’ai appris sur le tas, comme beaucoup.

Nadine Pellet-Zwick : Je m’occupe depuis janvier 2013 d’« Arte Junior », une tranche consacrée aux enfants entre 8 et 12 ans. C’était nouveau pour moi, car précédemment, je m’occupais plutôt de documentaires de société. Concernant le travail multilingue, pour les enfants, on double et on voice-overise, on ne sous-titre pas.
Je suis arrivée chez Arte en 1994. Auparavant, j’avais travaillé pendant trois ans à France 3 Lorraine-Champagne-Ardenne sur un magazine européen qui s’appelait Continentales. Dans cette émission, j’ai commencé comme synthétiseuse2, puis avec le temps, je suis devenue responsable de la cellule de sous-titrage. On en faisait beaucoup ; pas de voice-over, pas de doublage, que du sous-titrage, y compris du sous-titrage en direct, ce qui est encore un autre exercice.
Anne-Laure Gougeon : J’ai fait des études germaniques, plutôt axées sur la littérature et l’histoire. J’avais très envie de rejoindre l’audiovisuel et c’est ce qui m’a amenée en Alsace, Arte semblant faire le lien entre ce que j’avais appris et ce que j’avais envie de faire. Après mon DESS, j’ai travaillé pendant six ans dans le service multilingue de la société de production Seppia. Tout est devenu très concret pour moi. Je ne faisais pas de traductions directement, j’étais plutôt dans la coordination. En revanche, j’ai appris la technique du sous-titrage et j’en faisais quand je le pouvais. En 2006, je suis partie de Seppia : après avoir travaillé pour Arte, j’avais envie de passer de l’autre côté. J’ai fait d’abord deux ans de CDD sur divers postes, essentiellement dans les rédactions car c’était là que je souhaitais arriver in fine. J’ai ensuite travaillé trois ans pour la direction de la chaîne, toujours dans l’idée de passer du côté des contenus dès que possible. Et depuis janvier 2013, je suis chargée de programmes dans l’unité « Connaissance » et je m’occupe essentiellement des magazines X:enius et Cuisines des terroirs.
Comment s’organise votre travail ?
Anne-Laure Gougeon : Nous disposons d’un service multilingue qui coordonne et attribue les commandes passées aux prestataires, c’est-à-dire aux sociétés de postproduction.
Philippe Muller : Sa fonction est double : il a un budget, qui doit être tenu et également dispatché ; et il s’occupe des plannings.
Nadine Pellet-Zwick : Nos collègues du multilingue ne connaissent pas forcément la qualité du travail ou les spécialités de chaque prestataire, puisqu’ils ne travaillent pas sur la « matière ». Mais ils nous demandent notre avis et tiennent compte de nos choix. Il est rare qu’ils nous refusent un prestataire, ils comprennent et connaissent nos arguments. L’exception, c’est le cas des appels d’offres : ils présélectionnent alors trois prestataires et nous demandent de les valider. Le choix final leur appartient, car il incorpore aussi des critères financiers, entre autres.
Anne-Laure Gougeon : Chacun de nous a un « chargé de multilingue » attribué à ses cases. On travaille toujours avec la même personne qui finit par savoir ce qu’on souhaite, entend quand on est content ou pas, et agit en fonction.
Vous vous occupez uniquement des versions françaises ?
Philippe Muller : Oui, et c’est relativement nouveau. Cela tient à des soucis d’efficacité, de rentabilité. Il y a des gens dans la maison – mais ce n’est pas obligatoire et c’est très bien comme ça – qui pensent être capables de travailler dans les deux langues, mais de moins en moins.
Nadine Pellet-Zwick : Pour ma part, je n’ai jamais travaillé vers l’allemand et je n’en ai pas les compétences. Je comprends parfaitement tout ce qui se dit dans un programme, mais je ne me sens pas capable de travailler en détail sur le texte dans une autre langue que la mienne.
La traduction, au cœur de la programmation d’Arte
Quelle est la place des traductions dans vos postes respectifs ?
Anne-Laure Gougeon : C’est loin d’être annexe. Si on faisait un « top 3 », ce serait dedans, peut-être même en première place.
Dans mon cas, X:enius est un magazine quotidien avec 180 épisodes inédits par an tournés en Allemagne. Il arrive directement au service multilingue. On intervient à ce moment-là pour établir le bon de commande avec nos desiderata (traitement en voice-over, en sous-titrage, etc.). Je dis « on », car je gère X:enius avec ma collègue Valérie Theobaldt. C’est un magazine qui « roule » : le choix des techniques et les comédiens sont récurrents. Il s’agit toujours des six mêmes présentateurs, voice-overisés par les mêmes voix françaises. Je n’ai pas grand-chose à faire à ce stade. Il en va de même pour Cuisines des terroirs : c’est une émission qui existe depuis quinze ans, avec une voix de commentaire qui fonctionne très bien, personne n’a envie de changer !
Plus tard, on intervient bien sûr quand on reçoit les traductions, pour les relire et les adapter au besoin. Je ne vais pas beaucoup aux enregistrements de ces deux cases, car là aussi, c’est rodé. Pour X:enius, les castings ont été très précisément travaillés au lancement du magazine il y a six ans : six voix de présentateurs et deux voix de commentaire. On sait qu’ils vont faire du bon travail et que ces voix françaises épousent parfaitement leur personnage allemand. C’est assez drôle, car il y a même une forme de mimétisme qui s’installe : ils se connaissent par cœur et ne sont pas interchangeables. En revanche, quand je m’occupe ponctuellement d’autres séries ou d’autres programmes – « Arte Découverte », par exemple – j’ai à chaque fois une réflexion et une discussion sur les voix avec le directeur artistique et dans ce cas, j’aime bien aller en enregistrement. Cela permet d’entendre, enfin, ce qu’on s’était imaginé au moment des choix de casting et de la relecture.
La qualité de la version française est capitale, puisque tous les présentateurs de X:enius parlent en allemand, y compris les Français. En décembre dernier, on a mené une étude sur le magazine dans six villes de France et d’Allemagne. En France, la moitié des personnes interrogées n’avaient pas repéré que l’émission était en allemand à l’origine. Pourtant, on entend bien les voix sous la voice-over. C’est assez drôle… et c’est bon signe ! Je pense que si X:enius marche aussi bien en France, c’est dû entre autres à la qualité de la version française, c’est-à-dire aux comédiens et aux traductions, qui sont bien adaptés au magazine.
Philippe Muller : Chez nous, c’est un peu différent car chaque programme est unique. Il s’agit essentiellement de documentaires produits par des équipes françaises ou allemandes, mais le terrain de jeu est le monde entier : vous pouvez avoir un film allemand qui parle du Nigeria comme un film français qui parle de Fukushima au Japon. Ce qui fait qu’on rencontre plein de langues et plein de situations différentes.
Les mêmes questions se posent donc rituellement à chaque documentaire : de quel type de programme s’agit-il, de quoi est-il fait, quel est le traitement linguistique le mieux approprié ? Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte : le sujet, l’écriture du programme, les personnages qui interviennent, la présence éventuelle d’archives… Mais aussi l’heure de diffusion : prime-time, deuxième ou troisième partie de soirée, voire programme de nuit. On passe beaucoup de temps à visionner le programme pour déterminer le traitement le plus adapté à chaque phase du film.
Je choisis le prestataire. Pour toutes les raisons précédemment évoquées, je souhaite que le documentaire soit traité dans telle ou telle maison, parce qu’elle a un pool de comédiens qui à mon sens rendront service au film, ou parce que je sais qu’elle a un excellent traducteur littéraire de l’anglais vers le français, etc. J’oriente donc le choix en fonction de l’idée que je me fais de la version linguistique. J’y tiens beaucoup, je considère que c’est mon rôle. Ensuite, je donne des indications sur le type de traduction que je souhaiterais avoir. La commande part chez le prestataire, elle revient, je relis, j’adapte s’il le faut – et souvent, il le faut. Si c’est possible, je vais aux enregistrements de A à Z. Une traduction corrigée sur un écran d’ordinateur et un bout de papier ne produit pas le même effet que quand vous êtes physiquement présent dans un auditorium, avec des comédiens qui ont par exemple du mal à prononcer un mot. Quand je ne peux pas être présent, souvent au moment où le programme me revient, j’ai des regrets, j’aurais voulu changer certains mots. J’ai tendance à rester focalisé dessus lors de la diffusion à l’antenne ! J’accorde aussi une très grande importance au choix des comédiens et à celui de la voix principale quand il y a une narration. On peut « casser » un programme avec une voix irritante et le spectateur finira par zapper si le documentaire n’est pas assez passionnant. J’insiste toujours aussi pour savoir qui sera le directeur artistique car là encore, on peut avoir des sensibilités très différentes. Le travail multilingue est aussi la partie la plus visible d’Arte, pour le téléspectateur. C’est là qu’on s’affiche.
Qu’en est-il dans les programmes jeunesse ?
Nadine Pellet-Zwick : C’est un peu différent. Je dispose d’un budget avec lequel j’achète et je produis. On ne travaille pas sur des unitaires, pour les enfants, il est préférable de diffuser des séries pour tâcher de les fidéliser. On essaie donc de produire trois ou quatre séries par an et, pour le reste, j’achète dans le monde entier des programmes ludo-éducatifs intéressants et pas crétins, ce qui est assez rare ! La langue d’origine n’est pas forcément l’allemand.
Il s’agit essentiellement de séries de fiction à doubler (dessins animés ou live). J’ai pris l’habitude de choisir mes auteurs de doublage. Pour moi, le doublage labial est vraiment un travail en binôme : on travaille ensemble, on est ensemble devant la bande rythmo, et il est donc important d’être en adéquation avec l’auteur. Cela détermine aussi le choix du prestataire : certains paient le voyage à l’auteur pour venir rencontrer le chargé de programmes, d’autres non. Or pour moi, c’est fondamental. On ne peut pas se passer de la vérification, d’autant que par la suite, on est l’unique relais en plateau, l’auteur n’étant pas présent à l’enregistrement. Cette case comporte aussi des documentaires de format court, 13 ou 26 minutes. 13 minutes est pour moi le format idéal.

Concernant le travail sur le texte, je constate que peu de traducteurs sont formés à traduire pour un public enfantin. Je retrouve parfois des formules très ampoulées, des phrases compliquées, des propositions relatives qui font trois lignes, et ce n’est pas adapté aux enfants. Mais je peux le comprendre. Parler aux enfants et notamment par le biais du langage audiovisuel, c’est une gymnastique que j’ai dû apprendre, moi aussi. Une « gymnastique », parce qu’on essaie de trouver des synonymes moins compliqués tout en gardant à l’esprit qu’on souhaite aussi apprendre des mots aux enfants. Il faut qu’ils trouvent la clé, quelque part dans le programme, pour comprendre le mot qu’ils ne connaissent pas. Je passe donc beaucoup plus de temps à travailler sur l’écriture que je ne le faisais quand je m’occupais des documentaires de société.
Les enregistrements sont également plus compliqués, parce qu’on fait souvent appel à des comédiens enfants. Ils doivent se reposer une demi-heure au bout d’une demi-heure de travail, on ne peut pas les faire travailler au-delà d’une certaine durée, ils ont des obligations scolaires et se fatiguent vite. Avec deux prestataires strasbourgeois, on a ainsi créé un petit pool d’enfants ou de très jeunes adultes qui ont des voix d’enfant, avec lesquels on travaille. On a appris un peu tous ensemble, avec nos connaissances préalables du métier, mais sans cette habitude de travailler pour un jeune public. La grande difficulté pour tout le monde, c’est qu’on ne sait pas exactement qui nous regarde ! La case s’adresse aux 8-12 ans, mais on sait très bien que c’est une vue de l’esprit : il y a des enfants plus petits qui nous regardent, des seniors, peut-être un public familial, c’est assez opaque. Il faut donc faire en sorte que tout le monde y trouve son compte.
Histoires de méthode
Vous parlez tous de relire et d’adapter les textes des traducteurs. Comment procédez-vous ?
Philippe Muller : Pour ma part, je fais deux lectures. Une première lecture de « fluidité » : j’écoute l’allemand et je lis la traduction française qu’on me propose. Est-ce que c’est fluide, est-ce que je n’achoppe pas sur une phrase, est-ce qu’il n’y a pas de faux-sens… Puis je fais une deuxième lecture beaucoup plus précise : je vérifie les dates et les données, je m’assure qu’il n’y a pas d’erreurs dans les noms propres ou encore qu’on n’a pas ajouté ou enlevé un siècle quelque part. Ces deux phases prennent du temps.
Nadine Pellet-Zwick : En doublage, je travaille avec l’auteur car le moindre changement a une incidence. Je ne maîtrise pas le logiciel de doublage Mosaic et je reçois de toute façon un fichier Word : on ne peut pas travailler sur du papier en synchro. C’est l’auteur qui manipule le logiciel et mes propositions ne sont pas forcément valables. Ce travail en binôme est important.
Pour la voice-over, je procède également en deux phases. Une première lecture avec l’allemand, pour vérifier la fidélité. Ce matin, j’ai ainsi trouvé « die Regie » traduit par « la régie3» : il fallait avoir les deux textes pour repérer l’erreur. Puis une seconde lecture au cours de laquelle je fais aussi la réécriture nécessaire. Là, en revanche, je m’offre beaucoup plus de liberté au stade des corrections, tant que le texte tient dans le temps imparti. Du moment que le sens y est, je ne colle pas au texte. Les traducteurs n’ont pas tous les mêmes compétences : certains utilisent beaucoup de synonymes et ont une grammaire très fluide. Mais chez d’autres, les mêmes mots reviennent tout le temps et on a l’impression que le texte est fermé, manque de fluidité.
Philippe Muller : Certains traducteurs capitulent aussi devant la difficulté. Soudain, on s’aperçoit qu’une phrase a disparu, alors que c’était une idée essentielle. Pour passer de A à C, il manque B. Parfois, on sent que si B a disparu dans l’adaptation, c’est parce que la phrase était un peu compliquée, un peu obscure… Il arrive qu’on puisse supprimer une phrase, mais parfois, c’est vraiment une erreur et il faut la réintégrer, sans quoi le téléspectateur serait perdu devant une explication incomplète.
Anne-Laure Gougeon : Pour moi, la liberté totale est dans le commentaire. Mais il est vrai qu’il m’arrive aussi de m’éloigner du texte sur les passages en voice-over. On reste fidèle évidemment à ce qui est dit, mais s’il faut inverser des phrases ou changer des mots pour que le propos soit plus audible et compréhensible, on n’hésite pas.
Adapter, jusqu’où ?
C’est un grand débat parmi les traducteurs : à quel point doit-on adapter ? Comment départager les décisions qui relèvent du traducteur des choix rédactionnels qui sont du ressort de la chaîne ? On pense parfois bien faire en remaniant un commentaire de documentaire ou en sabrant dans le texte, or il arrive que les corrections d’Arte aillent dans le sens inverse.
Anne-Laure Gougeon : Il est difficile de répondre à votre question de manière globale, car c’est du cas par cas. Pour X:enius, de la même manière que les comédiens sont toujours les mêmes, on a toujours la même équipe de traductrices. Elles nous font souvent des propositions appuyées de recherches, suggèrent des suppressions quand il y a des redites, réorganisent certains paragraphes pour des raisons de logique… Ce qu’on ne perd pas de vue quand même, c’est qu’on ne vous donne pas toujours des « cadeaux » à traduire. Il faut parfois beaucoup de travail pour rendre le commentaire intéressant en français et éviter l’écueil de la simple description de l’image. Je reconnais que dans certains documentaires, tout le commentaire serait à réécrire. On voit bien le travail que vous faites et on ne peut que vous en être reconnaissants : on n’aurait pas forcément le temps ni les compétences pour le faire. Pourtant, ce n’est pas stricto sensu votre travail. Il est normal que vous vous posiez des questions, d’autant plus que vous travaillez sur des formats différents pour des rédacteurs différents. Un documentaire n’est pas traité de la même manière qu’un magazine, par exemple.
Nadine Pellet-Zwick : Sur certaines cases, il y a effectivement beaucoup de remplissage. Pour moi, on peut sabrer dans le commentaire sans problème. Vous, traducteurs, vous êtes aussi les premiers téléspectateurs de ces programmes. Il n’y a pas de secret : si vous trouvez que le texte mérite objectivement d’être allégé, c’est que le téléspectateur trouvera lui aussi qu’il est lourd. Et du moment que le chargé de programmes est du même avis, il en assumera la responsabilité.
Philippe Muller : Cela dit… L’autre jour, j’ai regardé un programme sur les maladies chroniques chez les enfants. Il s’agissait d’un documentaire tourné essentiellement en Allemagne, un 52 minutes : un format à la fois long et court, pour faire le tour d’une telle question. Je ne me suis pas occupé de la version française, mais je l’ai regardé chez moi parce que le sujet m’intéressait. Il était horriblement dense, le commentaire et la voice-over alternaient sans arrêt, on n’avait pas un moment pour respirer. Mais je n’aurais pas voulu manquer une seule phrase. Chacune avait son importance. Que faire dans un cas pareil ? J’étais malheureux ! Il aurait fallu aérer parce qu’on était bombardé de notions toutes très importantes. Ça parlait de médecine, d’humain, de ressentis, d’expériences… Tout était important : une phrase ou une idée en moins, et c’était fichu. Ce n’était pas un problème de traduction, ça tenait au film lui-même. Il aurait fallu ajouter dix minutes au film ou ôter quelques séquences.
Anne-Laure Gougeon : C’est souvent le cas dans les documentaires scientifiques et je crois que c’est une sorte d’indigestion nécessaire. Le format de la case exige de plonger dans des questions complexes que l’on peut difficilement éviter. Le problème, c’est aussi que ces documentaires sont programmés tard. Regardés à une heure moins tardive, ils paraîtraient peut-être moins indigestes !
Il nous arrive aussi de faire beaucoup de propositions « en marge » de nos traductions : des coupes, des explications pour justifier que l’on s’éloigne de la version originale parce qu’il y a des erreurs, des lourdeurs, des redites, etc. Êtes-vous demandeurs de ce type de suggestions ou préféreriez-vous faire ces choix vous-mêmes ? Cela vous gêne-t-il qu’on sous-entende que le programme a peut-être beaucoup de défauts ?
Nadine Pellet-Zwick : Tout ce qui me dérange, personnellement, c’est que le traducteur n’assume pas ses choix et laisse une série de propositions. Ça arrive parfois, on a une formulation « ou » une autre. Ça, je n’aime pas. Si vous prenez une décision, vous faites un choix et vous l’assumez. Si ça ne me convient pas, je mettrai autre chose de toute façon et ce n’est pas grave. Je préfère une unique solution avec une note expliquant « j’ai pris la liberté de… ». Je pense que c’est important d’assumer son travail quand on est traducteur. En tout cas, ça ne me « choque » pas, ce n’est pas un tabou. On sait qu’on ne diffuse pas que des chefs-d’œuvre.
Anne-Laure Gougeon : En effet, toute suggestion est bienvenue. Généralement, on me propose une traduction fidèle au texte et, si la traductrice estime qu’on peut le faire autrement, j’ai effectivement la note de bas de page qui dit : « Je proposerais volontiers de mettre ça… », avec une seule proposition. La plupart du temps, la proposition est non seulement bienvenue, mais tout à fait justifiée et beaucoup plus jolie que l’original. Dans 90 % des cas, c’est la version que je retiens. Et effectivement, libre à nous de ne pas l’accepter. Il m’arrive de me dire : « C’est subjectif, mais du point de vue du sens, ici, je préfère rester plus proche de l’allemand.» Mais pour moi, c’est bienvenu.
C’est important pour nous, car on se pose beaucoup de questions pour savoir « vers quoi aller » dans la version française, à quel point on peut se permettre de réécrire.
Nadine Pellet-Zwick : On pourrait échanger au moment où la commande vous est confiée. Souvent, je n’apprends qui est le traducteur qu’à la fin de la validation, car son nom figure dans les crédits finaux. Les prestataires n’aiment pas toujours donner le nom des traducteurs, ce qui est dommage. Une fois que vous travaillez avec un chargé de programme dont vous savez qu’il préfère que vous vous éloigniez du texte ou au contraire que vous en restiez près, c’est plutôt bien, vous pouvez adapter aussi votre façon de travailler. Et ça évite à tout le monde de perdre du temps.
Des rapports entre traducteurs/adaptateurs et rédacteurs
Ce serait très intéressant pour nous d’échanger en amont, afin de savoir ce que vous souhaitez pour tel programme. On part du principe que « ça ne se fait pas » pour ne pas court-circuiter nos propres clients que sont les prestataires et, par ailleurs, tous vos collègues n’accueilleraient peut-être pas favorablement ces demandes.
Philippe Muller : C’est aussi unitaire que nos programmes, chacun a sa façon de travailler.
Nadine Pellet-Zwick : Personnellement, je ne vois pas qui refuserait de discuter avec vous en amont, ces échanges feraient gagner du temps à tout le monde.
Anne-Laure Gougeon : Les prestataires risquent de ne pas être très contents. Déjà que le chargé de programme peut choisir son prestataire, si en plus il choisit son traducteur, le prestataire aurait de quoi se sentir un peu floué. C’est son travail de dispatcher les commandes. Je crois que ce système est aussi pensé pour que tout le monde ait du travail et pour maintenir une certaine forme d’objectivité. Autrement, le rédacteur qui aurait trouvé le traducteur de ses rêves ne travaillerait plus qu’avec celui-là ! Et à l’inverse, il refuserait catégoriquement un adaptateur dont il n’a pas apprécié le travail lors d’une commande précédente. Cette organisation permet de maintenir une sorte de brassage et une certaine ouverture, pour tous ceux qui arrivent sur le marché.
Philippe Muller : Les deux formules présentent des avantages et des inconvénients. Aucun de nous ne serait opposé à une conversation avec le traducteur. Dès lors qu’on sait de qui il s’agit, il peut être intéressant de parler du degré de difficulté, du niveau de langue qu’on tient à avoir et ainsi de suite. Après livraison de la traduction, on pourrait aussi discuter de telle ou telle formulation et travailler ensemble à fluidifier le texte ou à le rendre plus accessible. D’un autre côté, comme l’a dit Anne-Laure, il pourrait aussi se produire un phénomène de rejet. Si l’on pense d’emblée que le travail d’untel sera mauvais dans tous les cas, on risque d’y aller à reculons et de corriger le texte avec beaucoup d’a priori. Pourtant, nul n’est à l’abri d’une petite panne de régime et il arrive qu’un traducteur tombe sur un sujet ardu ou avec lequel il n’a aucune affinité… Mais il faut bien vivre ! Personnellement, ça ne me gêne pas de ne pas connaître l’identité du traducteur ou de la traductrice quand je démarre une relecture ou un rewriting. J’aborde cette tâche la tête fraîche : le texte, toujours le texte, rien que le texte.
Nadine Pellet-Zwick : C’est peut-être différent sur les séries, où il m’arrive de corriger dix fois de suite les mêmes choses. Par exemple j’ai des ados qui discutent et l’auteur écrit : « Qu’en penses-tu ? ». Là, je me dis que ce n’est pas possible… Même sur Arte, des gamins qui se parlent entre eux ne se demandent jamais « Qu’en penses-tu ? ». Je remplace par « Qu’est-ce tu penses ? » et à l’enregistrement, je le fais même prononcer « Kèss tu penses ? ». Autrement, les enfants risquent de se sentir exclus. Déjà, je n’en connais pas un qui se lève le matin en se disant : « Chouette, je vais regarder Arte ! » Si on veut essayer de capter leur attention, on n’attire pas les mouches avec du vinaigre et « qu’en penses-tu », ça ne passe pas… Pour ce genre de choses, je pense que c’est bien de se parler au départ et de faire une mise au point pour s’assurer qu’on est d’accord : dans cette série, on a des enfants de dix ans et on va les faire parler naturellement. Autrement, s’il faut que je rectifie les mêmes erreurs dans les dix épisodes, c’est contraignant. Pour vous aussi, d’ailleurs, j’imagine qu’il est frustrant de voir revenir vos traductions avec du rouge partout.
On n’a pas toujours les corrections. On nous les transmet spontanément quand il y a un gros problème, mais souvent, il faut les réclamer.
Anne-Laure Gougeon : C’est dommage, mais n’hésitez pas à les demander à vos interlocuteurs dans les sociétés de postproduction : une fois qu’ils les ont reçues, il leur suffit de les transférer. Et bien sûr, c’est comme ça qu’on avance.
Histoires de qualité
Vous arrive-t-il souvent de refuser des traductions ?
Nadine Pellet-Zwick : Refuser en bloc, c’est rare en ce qui me concerne. Il faut vraiment que ce soit extrêmement mauvais.
Philippe Muller : Moi, ça m’arrive. Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte. Je le fais quand la production a du temps devant elle, quand il n’y a pas d’urgence de diffusion. Et quand, au bout de la troisième page, c’est noir partout – je ne corrige pas en rouge ! –, cela veut dire qu’il y a un réel souci d’adaptation. Là, je ne vais pas jusqu’au bout de la relecture et je renvoie le texte en demandant que l’on confie à un autre traducteur le soin de faire ce travail. Mais quand le temps manque, surtout s’il y a urgence de procéder aux enregistrements, je m’en occupe moi-même, parfois jusque tard le soir. Là, on perd un temps fou. Des ornières se forment et se creusent, on n’arrive plus à en sortir. On a beau y passer du temps, ça coince toujours.
Nadine Pellet-Zwick : C’est d’autant plus difficile qu’on est influencé par la mauvaise traduction et qu’on a du mal à reformuler les choses. Mais c’est tout de même assez rare, en ce qui me concerne, de l’ordre d’une fois par an.
Anne-Laure Gougeon : Sur mes cases récurrentes, j’avoue que ça ne m’est jamais arrivé, mais je n’occupe ce poste que depuis 2013. Très ponctuellement, en revanche, je traite des séries pour la case « Découverte ». Je veux bien que le programme d’origine soit très mal écrit, mais il m’est arrivé qu’on m’envoie une traduction uniquement faite de mot à mot, calquée sur la syntaxe allemande… Je l’ai renvoyée tout de suite en demandant au prestataire de la reprendre et de la réadapter.
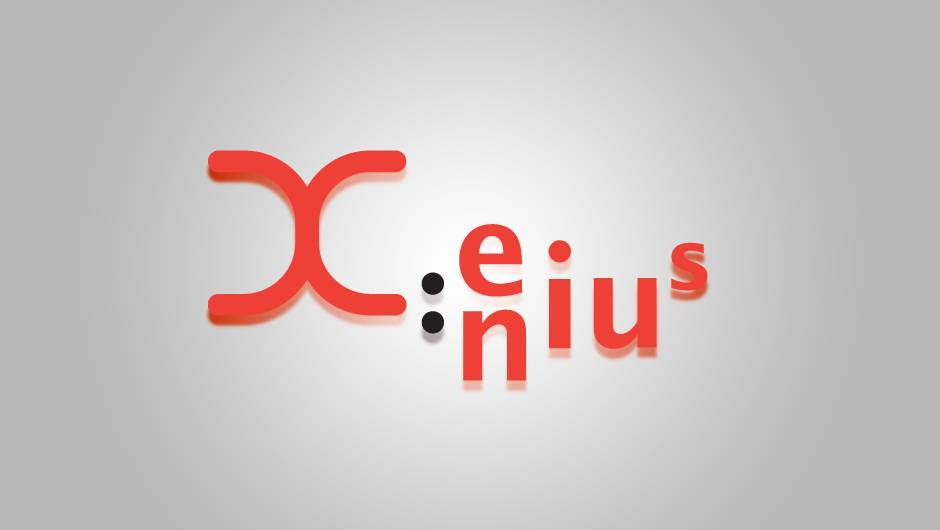
Faites-vous le point, régulièrement, avec les prestataires ? Quels sont vos contacts avec eux ?
Philippe Muller : Il m’arrive de temps en temps de commenter les corrections que je fais. Dans ce cas, j’appelle le prestataire pour en discuter en détail, afin qu’on ne retombe pas dans les même erreurs pour le programme suivant. J’aime bien ces échanges. Mais le plus souvent, c’est au moment de l’enregistrement qu’on se parle, dans l’auditorium.
Je change encore pas mal de choses quand je vais aux enregistrements, surtout si je n’étais pas suffisamment concentré au moment de la correction, si le téléphone a sonné, si je n’étais pas seul dans le bureau, s’il y avait du bruit, etc.
Nadine Pellet-Zwick : Et puis on se projette dans la voix, la personne, l’intonation… Une fois qu’on est face aux comédiens avec leurs compétences mais aussi leurs limites, on s’aperçoit que certaines choses ne fonctionnent pas, tout simplement.
Philippe Muller : Il m’est arrivé de regretter de ne pas avoir assisté à un enregistrement, en me disant : « Ils auraient quand même pu changer ce truc-là… » Les directeurs artistiques m’appellent parfois pour me parler d’un passage particulier et suggérer des modifications. Quand je suis disponible, on en discute. Parfois, ils font aussi plusieurs prises différentes et me demandent de choisir celle que je préfère. On travaille tous dans un même intérêt, qui est celui du programme. On recherche l’accessibilité, la fluidité, il faut que ce soit du vrai français, on traque les germanismes et les formules bancales. C’est hyper-important.
De l’évolution des modes d’adaptation
Quelle est la place du sous-titrage dans vos postes respectifs ?
Nadine Pellet-Zwick : Il y a clairement une volonté de la direction de sous-titrer de moins en moins, car il paraît que les sous-titres font zapper les téléspectateurs.
Philippe Muller : Je constate que ma pratique quotidienne a évolué, depuis mes débuts ici. De nos jours, on voice-overise même des situations de dialogue entre des personnes qui ne sont pas face caméra, des séquences qui relèvent de la conversation ou de l’ambiance. En revanche, le pôle d’Arte à Issy-les-Moulineaux sous-titre encore beaucoup, même à l’excès, par moments. Mais on nous encourage à favoriser la voice-over, la parole, plutôt que la lecture. A fortiori quand il s’agit de programmes de prime-time ou, bien sûr, d’œuvres destinées à des publics particuliers, comme les enfants. C’est plus compliqué, à mes yeux, d’adapter, de synthétiser des idées et des informations dans un nombre restreint de caractères. La gymnastique est différente et les contraintes sont plus restrictives.
Nadine Pellet-Zwick : Pourtant, il y a parfois des aberrations et même une forme de schizophrénie à dire : « Puisque la diffusion ne se fait pas à une heure de grande écoute et qu’elle est destinée à un sous-public, on va aller au moins cher. » Forcément, doubler pour les enfants, ça coûte plus cher, mais il faut savoir ce qu’on veut ! Moins il y a de public, plus on est incités à aller vers le sous-titrage, moins onéreux. C’est le cas pour tout ce qui est diffusé après minuit, par exemple. Autrefois, ces choix-là ne dépendaient absolument pas de l’horaire mais du programme : dès qu’on avait des passages en cinéma direct4, c’était du sous-titrage. Mais ces règles-là n’ont plus cours.

Philippe Muller : Oui, à l’époque, on pouvait avoir un documentaire en prime-time avec très peu de narration, mais beaucoup de cinéma direct entièrement sous-titré. Aujourd’hui, ce n’est plus envisageable. Il y a même eu un temps où l’on diffusait parfois deux versions d’un même documentaire. Initialement, Arte commençait à émettre à 19 heures et s’arrêtait à 3 heures du matin ; il y avait donc très peu de rediffusions. Puis la durée d’antenne a augmenté pour passer à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le nombre de rediffusions s’est alors accru, de sorte qu’un film programmé à 20 h 15 pouvait très bien être rediffusé la semaine suivante à 23 h 30. Si on jugeait qu’il était dommage de recouvrir tout un programme avec de la voice-over, on parvenait parfois à obtenir une seconde version, sous-titrée, pour la rediffusion. Quand Nelson Mandela parle en anglais, on a envie de l’entendre, même si ce n’est pas une archive ! Il fallait se montrer persuasif pour débloquer l’argent nécessaire, mais ça coûtait moins cher qu’une version sous-titrée de A à Z, car la version voice servait de base pour la traduction. Ce n’était évidemment pas systématique, je le faisais pour des écritures particulières, de grandes signatures.
Ça, c’est terminé, pour des questions de budget et de volonté politique de la chaîne. Je le regrette, personnellement. Une œuvre, c’est une œuvre. On parlait d’» œuvre », à l’époque. Maintenant, on parle de « fichiers », de « numéros ». Mais chaque film est unique et mérite un traitement adapté, quelle que soit l’heure à laquelle il est diffusé. Il faut aussi faire en sorte de respecter les choix artistiques du réalisateur et de l’équipe qui a produit le film.
Anne-Laure Gougeon : C’est aussi lié aux évolutions technologiques. Auparavant, le budget de la chaîne était exclusivement consacré à l’antenne, tandis qu’aujourd’hui, Arte investit aussi beaucoup dans le web, parce que c’est stratégiquement nécessaire. Forcément, cet argent-là n’est plus disponible pour autre chose.
Avez-vous l’occasion de travailler pour le web ?
Anne-Laure Gougeon : Oui, progressivement, puisque nos intitulés de poste indiquent maintenant « chargé de programme antenne/web ». Avec X:enius, je suis assez présente sur la plateforme « Arte Future » et le web est vraiment intégré dans mon raisonnement. Je programme mes épisodes de X:enius en lien avec le planning de l’équipe d’Arte Future, qui est installée dans le bureau voisin. On s’efforce de travailler dans une optique de complémentarité. Notre idée est aussi que le web et l’antenne peuvent être chacun le miroir de l’autre et se promouvoir mutuellement, d’autant que notre public est assez large. Un temps, nous avions d’ailleurs développé un court module intitulé Xenial destiné à Arte Future : en une minute environ, à partir d’un thème traité dans un X:enius, ce petit sujet approfondissait un point précis, posait une question inédite ou un peu rigolote.
Notre service multilingue se chargeait de répartir la traduction de ces petits modules entre nos prestataires habituels, en tenant surtout compte de questions de planning. Si un présentateur de X:enius que l’on retrouvait dans Xenial était en enregistrement chez tel prestataire, on essayait de caser ce petit sujet dans le planning, pour des questions de coûts. Ce n’était pas nécessairement le même traducteur qui s’occupait de l’épisode de X:enius et du Xenial correspondants, mais puisqu’il s’agissait d’un sujet très court, ce n’était pas forcément très grave. Xenial n’existe plus, mais nous travaillons actuellement sur d’autres projets pour maintenir cette complémentarité entre web et antenne.
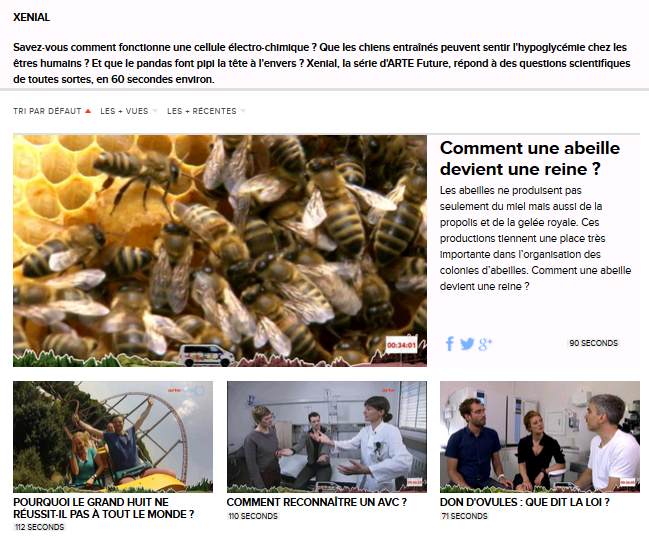
Philippe Muller : Par ailleurs, beaucoup de bonus et de sujets courts, qui sont tournés en complément d’un documentaire à l’antenne et sont destinés exclusivement au web, sont traduits en interne.
Un dialogue à renouveler
Pour revenir à ce que suggérait Nadine Pellet-Zwick : cela vous paraîtrait-il intéressant d’organiser une réunion entre rédacteurs, traducteurs et prestataires travaillant régulièrement pour Arte ?
Nadine Pellet-Zwick : Pour moi, ça coule de source. Vous écrivez pour des programmes dont on a la charge et nous travaillons sur vos textes, ça me paraît une évidence. Et je m’étonne, année après année, que ça ne se fasse pas. Ce n’est pourtant pas faute de le demander.
Les prestataires ne seraient pas forcément très partants…
Nadine Pellet-Zwick : … tout comme le service multilingue, du reste. Pourtant, ça me paraît tellement évident !
Philippe Muller : Il faut distinguer deux plateformes : il y a l’échelle artistique et l’échelle commerciale, qu’il ne faut pas sous-estimer. Mais le dialogue me semble une bonne chose, il permettrait de définir un certain nombre de principes communs. Cela nous éviterait dans certains cas de dire et redire les choses ; on pourrait aller plus vite, dans les choix d’adaptation, vers telle ou telle direction. Cette démarche n’aurait pas d’influence sur le rôle du service multilingue : le budget reste un élément à part et se parler ne coûte rien.
Nadine Pellet-Zwick : Je ne veux bien sûr pas parler pour l’ensemble des rédacteurs, mais je pense que nous serions un certain nombre à souhaiter ce dialogue et que notre hiérarchie pourrait l’entendre. Cela permettrait de mettre sur la table les points délicats, en discutant par grandes catégories de programmes : documentaires de découverte, dossiers et investigation, sciences, etc.
Par ailleurs, je ne vois pratiquement jamais de traducteurs aux enregistrements. C’est dommage que vous n’alliez pas au moins une fois de temps en temps en plateau ! C’est important aussi de voir ce que devient le texte que vous avez écrit et de le voir prendre vie. On se rend beaucoup mieux compte de ce qui « passe » ou non à l’oral. C’est une bonne piqûre de rappel !
Propos recueillis par Caroline Barzilaï et Anne-Lise Weidmann à Strasbourg, le 16 janvier 2015
