En 2012 et 2013, vous avez été juré pour le prix du sous-titrage cinéma. Parlez-nous de cette première expérience au sein d’un jury ATAA.
C'est une amie traductrice qui m'a proposé de rejoindre le jury parce qu'elle savait que j'allais beaucoup au cinéma. À l'époque, il n'y avait pas de rattrapage en DVD pour les jurés et il fallait voir les films en salle, au moment de leur sortie, en prenant des notes dans le noir pendant la projection ! J’ai accepté par curiosité. Au tout début, j’étais indulgent quand je voyais des erreurs dans les adaptations : je trouvais toujours des circonstances atténuantes, je ne voulais pas être trop sévère. Cependant, ce rôle m’a permis d’aiguiser mon œil, et de voir ce qui convient ou ce qui gêne dans le sous-titrage d'un film. Devenir juré offre l’opportunité de confronter les points de vue, de bénéficier de regards extérieurs et aide à prendre du recul. Surtout, nous devons développer nos arguments : impossible de se contenter d’un « j’aime » ou « je n’aime pas ». Toutes nos discussions sont très constructives. Être juré rend également plus critique sur notre propre travail. Cela nous inspire et donne des idées. Voir comment nos confrères et consœurs s’en sortent sur une formule compliquée enrichit notre savoir-faire.

Quels sont vos critères d’évaluation pour une bonne adaptation ?
Au sein du jury, nous n’attachons pas la même importance aux mêmes aspects. À titre personnel, outre le respect du sens, mes critères portent plutôt sur le naturel : j’attends que le texte « sonne » bien, et surtout qu’il ne me fasse pas « sortir du film ». Ce qui est le cas quand une phrase me semble bizarre ou que je ne comprends pas le sens d’une réplique. Selon moi, c’est le résultat qui compte, pas forcément la difficulté pour y arriver. En revanche, certains jurés préfèrent récompenser un film ou une série présentant davantage d’enjeux de traduction et un niveau de complexité élevé. Par exemple, une série ultra rapide où tous les personnages parlent en même temps, avec une profusion de jeux de mots ou un ping-pong verbal… En effet, il existe des textes plus compliqués à traduire que d’autres : la comédie en fait partie, tout comme les comédies musicales ou les films historiques… Certains jurés veulent valoriser les séries les plus difficiles, quant à moi je préfère sélectionner les versions françaises les plus réussies, quelle que soit la VO, l'idéal étant de trouver un équilibre entre les deux.
Pour les prix ATAA en sous-titrage Cinéma, vous avez également fait partie du comité de coordination pendant trois ans, et vous continuez de participer à la présélection des films. Quel est votre rôle ?
Délia D’Ammassa, ma partenaire de la présélection, et moi sommes de grands cinéphiles. En ce qui me concerne, je vais au moins cinq fois par semaine au cinéma. Et je pense qu’à nous deux nous couvrons pratiquement tout le spectre des sorties. Qu’il s’agisse de films d’auteur ou de blockbusters… De cette manière, nous indiquons au comité de coordination les films qui remplissent les critères d’éligibilité et les adaptations dignes d’intérêt en les classant en cinq catégories dans un tableau, des meilleures aux moins bonnes. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais quoi qu’il en soit, la sélection définitive appartient au comité de coordination et au jury. Nous n’intervenons pas dans les débats.
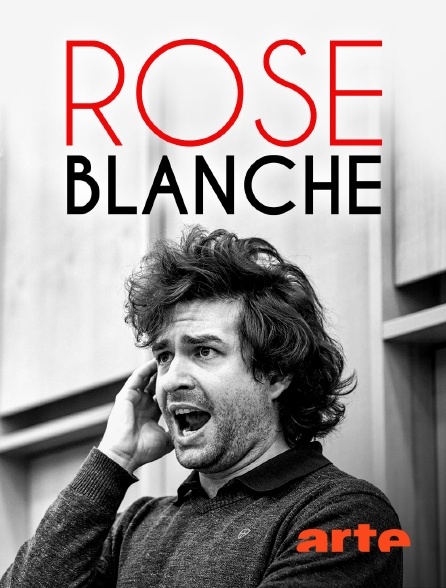
Avec une telle culture cinématographique, que pensez-vous de la qualité des adaptations en France ?
Même si je n’aime pas forcément le style de tous les adaptateurs, j’observe que les films signés – et donc assumés – relèvent souvent d’un travail de qualité. Pour les films non signés, en revanche, qui concernent souvent de petits distributeurs ou des œuvres tournées dans une langue rare, le résultat est parfois bâclé, sans aucun respect des normes et/ou réalisé dans des labos étrangers, avec des adaptations qui calquent la VO ou manquent de naturel. C’est particulièrement le cas des films de festival où la traduction est probablement organisée dans l’urgence, quelques jours avant l’événement. Pour la diffusion en salles, la traduction n'est pas toujours refaite. C’est vraiment dommage. Pour le festival de Deauville de 2020, certaines adaptations étaient catastrophiques, à tel point que des scènes entières n’étaient même plus compréhensibles : sous-titres sur trois lignes, fautes d’orthographe, codes informatiques oubliés à l’écran... À se demander s’il ne s’agissait pas de traduction automatique. Dans ce genre de cas, heureusement assez rare, on se rend compte que l’adaptation est vraiment la dernière roue du carrosse…
Pendant 17 ans, vous avez été salarié d’un laboratoire. Comment avez-vous finalement basculé dans le travail indépendant ?
Initialement, j’ai fait une école de traduction, l’ESIT, mais je ne connaissais rien à la traduction audiovisuelle. En 2001, de retour d’Australie – où j’ai travaillé pendant un an – j’ai su que le labo Vidéo Adapt recherchait un collaborateur. Après un test, j’ai été embauché. Et j’y suis resté pendant 17 ans ! Ce labo m’a tout appris : l’adaptation, les sous-titres, la voice-over… Je faisais à la fois de la traduction, de la relecture de programmes et beaucoup de simulations, notamment pour Arte. Mais seulement en documentaire, spécialité de ce labo. Avec le temps, je faisais de plus en plus de relecture et de moins en moins de traduction. Je rêvais de me consacrer davantage à l’adaptation et surtout de traduire de la fiction. Aussi en 2018, j’ai sauté le pas et j'ai démissionné pour devenir free-lance.

Avec 17 ans d’expérience, cela était-il plus facile de se lancer comme indépendant ?
Malgré mon parcours, personne ne me connaissait dans les autres labos. Sans repartir de zéro, il a néanmoins fallu que je les démarche individuellement et que je leur envoie mon CV. Par ailleurs, on me considérait comme spécialisé en documentaires. Dans notre milieu, les domaines sont parfois très cloisonnés. De même qu’il est difficile de passer de la télévision au cinéma, mon passage à la fiction n'a pu se concrétiser que grâce à la cooptation d'amies traductrices qui m’ont recommandé pour des séries en binôme. Progressivement, les labos m’ont fait confiance. Dans ce métier, le réseau est vraiment très important. Comme nous ne pouvons pas accepter tous les projets proposés, nous recommandons à nos clients des confrères et consœurs. Nous pratiquons en permanence le renvoi d’ascenseur.

Quel point de vue avez-vous sur les tarifs pratiqués dans la profession ?
Quand je me suis lancé comme free-lance, j’ai décidé d’un seuil de tarifs au-dessous duquel je ne descendrais jamais. Il m’est arrivé de refuser la mort dans l’âme des programmes qui m’intéressaient véritablement, car le tarif était insuffisant. Mais finalement, après une première année en dents de scie, j’ai eu la chance d’avoir toujours du travail. Même si j’ai conscience que ma situation n’est pas représentative de tous ceux qui débutent dans le métier, cette stratégie a été payante sur le long terme. En effet, quand on accepte un tarif bas, il est difficile ensuite de revenir à une rémunération correcte. On est étiqueté « bas tarif »… L’arrivée de la TNT dans les années 2000 nous l’a prouvé. La profession s’est enthousiasmée de l’augmentation du nombre de programmes à adapter. Nous avons même cru que les tarifs pourraient augmenter, mais c’est l’inverse qui s’est passé : les clients nous ont proposé des programmes bas de gamme par paquets de 20 ou 30 épisodes avec un système de tarifs dégressifs. Difficile de revenir en arrière… Mais la réalité est que nous ne pouvons pas adapter la qualité de nos traductions en fonction des tarifs.

Avec Charlotte Drake et Rachèl Guillarme, vous avez reçu le prix ATAA 2021 pour les sous-titres de la série Braquage à la suédoise. Comment se déroule une telle collaboration à trois ?
Au début, nous avons reçu les scripts en VO et Charlotte, qui est suédoise, nous les a traduits mot à mot en français. Puis Rachèl et moi avons adapté les textes dans un français plus idiomatique et plus adapté au sous-titrage. Grâce à l’allemand, je peux comprendre dans ses grandes lignes le suédois écrit, ce qui m'a aidé pour le calage. Néanmoins, nous restons totalement dépendants de notre binôme : la traduction littérale permet de comprendre le sens général, mais pas toujours l’intention. La réplique est-elle ironique ? Le personnage se montre-t-il empathique ? Parfois un simple mot dans la VO peut donner une tout autre signification à la phrase. Aussi, selon l’intention, on ne traduira pas de la même manière. Le deuxième enjeu de l’adaptation d’une langue rare comme le suédois est culturel : ce qui est immédiatement compréhensible pour un public suédois nécessitera parfois une explication pour les spectateurs français. Notre traduction doit évidemment introduire ces éléments de compréhension culturels.
Bien adapter semble relever de l’intelligence collective. Qu’en pensez-vous ?
Les collaborations en binôme ou en trinôme illustrent parfaitement le travail d’équipe de nos métiers. Même si le travail d’adaptateur reste au quotidien une activité solitaire, nous faisons toujours entrer d'autres traducteurs dans l’équation, pour la relecture ou l'harmonisation, mais aussi, dans le cas de la voice-over, le comédien et le directeur artistique. Notre mission est de rédiger des phrases faciles à mettre en bouche, parfois même d'indiquer les prononciations. En effet, nous avons tout intérêt à faciliter le travail de chacun. Nous avons tous envie que le résultat soit réussi. Je pense que c’est un milieu où il y a beaucoup de bienveillance. Celle-ci s’exprime aussi au sein de l’ATAA : c’est une force collective où chacun participe à sa mesure. Cela représente une vraie entraide.
