Quel a été votre parcours ?
J’ai commencé le japonais après le lycée. Comme beaucoup de jeunes de la génération Club Dorothée, j’avais consommé des dessins animés japonais à haute dose. Quand j’ai passé mon bac en 1996, la série de mangas1Dragon Ball explosait et Glénat commençait à la publier en français. C’était le début de l’arrivée massive des mangas sur le marché. Curieux, je me suis procuré une méthode Assimil pendant l’été et j’ai commencé à décrypter mes premiers noms de personnages de Dragon Ball Z, laborieusement, en japonais.
J’ai décidé de m’inscrire à un cursus de japonais à Bordeaux 3, sans avoir de projets très précis : j’aimais le japonais, c’est tout. C’était une toute petite UFR à l’époque, avec deux salles pour une grosse trentaine de personnes. Les effectifs commençaient à augmenter, justement grâce aux mangas, même si beaucoup d’étudiants s’arrêtaient après la première année. En 1999-2000, j’ai passé un an au Japon, grâce à un jumelage entre ma fac et l’université de Hirosaki, dans le nord de l’île principale du Japon. À mon retour en France, je suis parti faire un DEA à Paris 7 sur l’animation japonaise, et notamment sur Pompoko d’Isao Takahata [Heisei tanuki gassen pompoko, 1994].
Entre-temps, j’avais commencé à faire un peu d’interprétation et à écrire quelques articles dans AnimeLand, mais j’avais très peu d’expérience professionnelle. Je n’avais pas le feu sacré pour me lancer dans une thèse, surtout au vu des perspectives « dorées » que nous présentaient nos profs (très peu de postes de recherche). Et en première année de japonais, on nous avait dit d’emblée : « Vous ne serez pas tous traducteurs de mangas ! » J’ai donc cherché une formation professionnalisante. À Nanterre, il y avait un DESS de traduction audiovisuelle, qui existe toujours. Il dépendait cependant de l’UFR d’anglais, or je n’avais pas de formation en anglais. J’ai tout de même été accepté et j’ai appris quelques connaissances théoriques là-bas. J’étais le seul japonisant de la promo.
À la fin de ce cursus, on avait tous un stage à faire. Je n’ai même pas eu besoin de chercher, la société de doublage et de sous-titrage Chinkel a signalé à une de mes profs qu’elle cherchait des stagiaires. J’ai donc passé deux mois dans cette entreprise où j’ai fait des travaux techniques et appris à me servir du logiciel de doublage Cappella. À l’issue, j’ai travaillé à mon compte pendant trois ans environ.
Puis un ancien copain de la fac m’a contacté. Il travaillait pour le bureau européen de la grosse société d’animation japonaise Toei Animation.
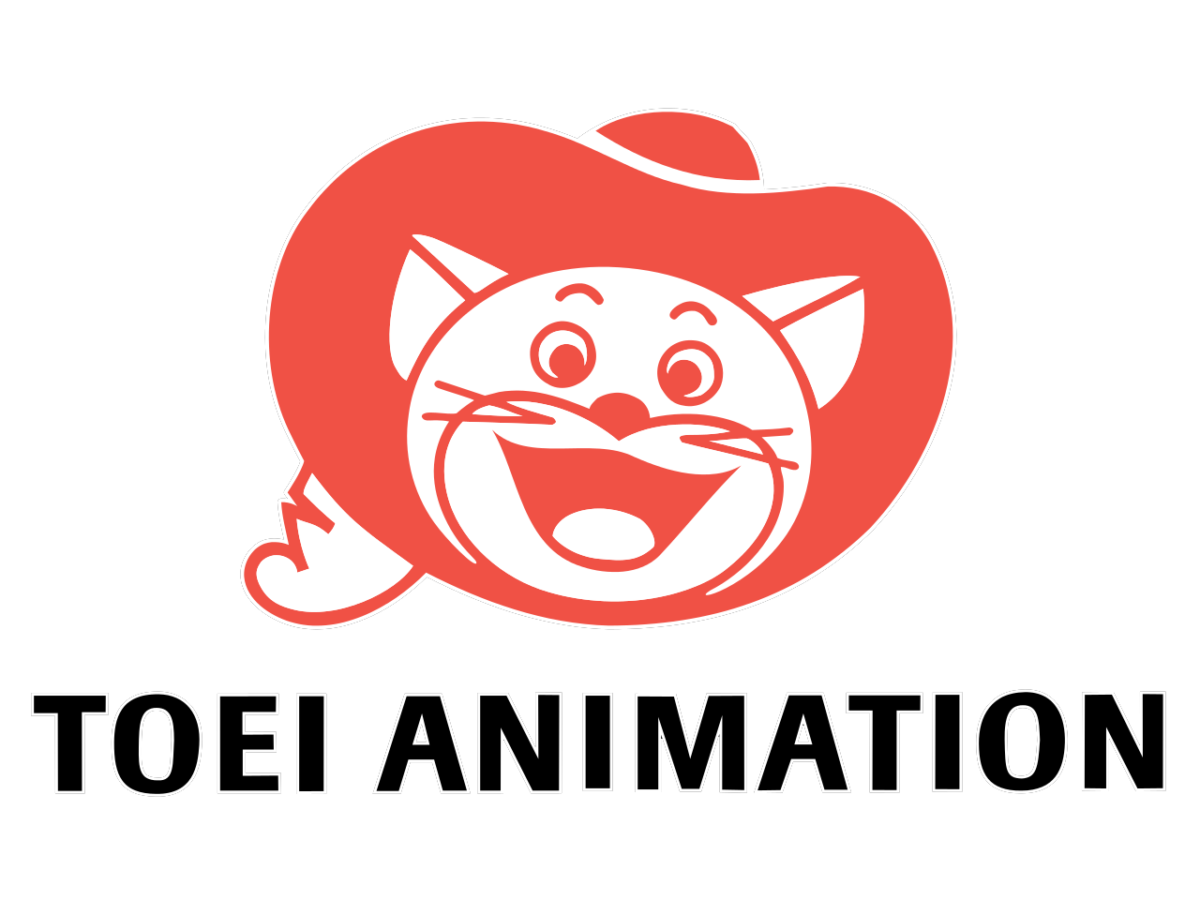
Travailler pour Toei Animation
Toei Animation dispose de plusieurs bureaux à l’international, dont un à Paris pour l’Europe. Une quinzaine de personnes y travaillent depuis 2005. Auparavant, Toei Animation mandatait des gens pour représenter ses droits et ses séries, il n’y avait pas de bureaux.
Du point de vue de son organisation, Toei Animation est un peu une exception. Cela dit, la chaîne de télévision publique japonaise NHK a un bureau et une équipe en France. Il y a également la société VIZ Media Europe, qui est le fruit de la collaboration de trois éditeurs japonais (Shūeisha, Shōgakukan, et ShoPro). Ils ont créé une holding pour mettre un pied aux États-Unis et en Europe. VIZ Media a racheté par exemple l’éditeur Kazé, premier éditeur historique de japanim [d’animation japonaise, NDLR] en France.
Cette évolution est due au développement de la popularité des anime ?
Entre autres. C’est principalement un bureau commercial qui vend des séries et des licences, fait du marketing, etc. Mais ils voulaient aussi suivre de plus près ce que devenaient leurs séries et notamment au stade du doublage. Ils cherchaient donc quelqu’un pour relire les scripts de doublage et faire un peu de supervision. Au départ, les deux « piliers » de la société s’en occupaient, mais le temps leur manquait – sans compter que l’un d’eux ne parlait pas du tout français.
Je n’avais jamais été salarié, je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience et je n’ai pas été déçu ! J’y ai passé quatre ans en tant que « chargé éditorial et littéraire », c’était mon titre.
L’une des grosses séries de Toei Animation est One Piece. J’ai supervisé le doublage de 300 épisodes environ. Même les adaptateurs qui travaillent régulièrement sur une série-fleuve comme celle-là ne peuvent pas connaître tous les choix de traduction qui sont faits (par exemple pour les 400 « attaques spéciales » utilisées par les personnages), suivre tous les rebondissements, savoir que tel surnom a été choisi pour tel personnage, etc.
Au Japon, l’ayant-droit de One Piece est un géant de l’édition, la maison Shūeisha, qui est extrêmement vigilante sur les adaptations. Il y a donc tout un processus de validation en place dans la collaboration avec Toei Animation. Mais ce mécanisme n’existe pas au stade du doublage en France.
One Piece avait connu un premier doublage sur une cinquantaine d’épisodes dans les années 2000, qui a vite été oublié. Entre autres, les noms n’étaient pas respectés, les voix de la VF ne correspondaient pas à la VO…
Quand je suis arrivé chez Toei, en août 2008, ils étaient en train de relancer One Piece et avaient déjà fait doubler ou redoubler quelque 150 épisodes. C’était leur grosse série, ils voulaient que ça marche et que le doublage soit de qualité. Une « bible » en français avait déjà été mise en place, progressivement. Mon travail a consisté à relire tous les scripts de doublage ainsi que les sous-titres, par la suite. Le tout pour des diffuseurs variés, généralement des chaînes de télévision.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est One Piece ?
C’est initialement un manga qui compte plus de 80 volumes. La série animée, elle, en est à plus de 700 épisodes. Au Japon, elle est diffusée depuis 1999 à raison d’un épisode par semaine, le dimanche matin, dans le cadre d’une case « jeunesse » très suivie, sur le réseau Fuji TV. Pour simplifier, c’est une histoire de pirates qui vont d’île en île en essayant de trouver un trésor fabuleux, peut-être mythique, qui s’appelle « One Piece ».
En France, la série a vraiment décollé depuis cinq ans environ. En fait, un premier doublage des 52 premiers épisodes avait été entrepris mais cela n’était pas allé plus loin que ça. Devant le potentiel de la série, il a été décidé plusieurs années plus tard de relancer un doublage de ces premiers épisodes, et d’aller plus loin, un fait rare.
Quelques années plus tard, on peut voir que durant le salon Japan Expo, en 2015, il y avait un colisée One Piece, et 150 m² consacrés à One Piece et à Dragon Ball Z. La série a trouvé sa place et son public.

Vos contacts japonais étaient-ils conscients des contraintes du doublage, de la difficulté de la traduction ? Est-ce qu’ils comparaient la VO et les versions doublées ?
Il y a peu de doublage pour les films étrangers, au Japon. En revanche, il y a une grosse culture de doublage pour les dessins animés, ou plutôt de postsynchronisation. Certains comédiens de doublage sont de vraies stars : ils sortent des albums de chanson et peuvent être invités dans les émissions de télé. Un comédien peut vivre à 100 % du doublage et n’en ressentir aucune frustration.
La plupart du temps, mon travail était assez créatif, c’était par exemple à moi de définir le nom d’une « attaque » en français : est-ce qu’on la garde en japonais, est-ce qu’il vaut mieux trouver un nom marrant en français… C’était le côté plaisant de ce travail, surtout après avoir travaillé en free-lance. Quand on est adaptateur à son compte et qu’on propose une idée, on a souvent des retours frustrants de la part du client qui a le pouvoir de décision et qui dit : « Non, on ne va pas mettre ton idée, on va mettre autre chose, c’est comme ça. » Parfois, on pouvait discuter longuement avec le client, mais parfois, il fallait suivre les termes adoptés.
C’était donc très agréable d’être de l’autre côté de la barrière. Je travaillais avec d’anciens confrères free-lance qui, je crois, étaient contents que je les relise. Ils savaient que je parlais japonais, que je connaissais bien les séries et que j’étais moi-même auteur, donc que j’avais conscience des contraintes. Ça se passait bien, dans l’ensemble.
Minute nostalgie
Vous parliez des 50 premiers épisodes de One Piece qui avaient été refaits. D’autres séries animées ont-elles connu le même sort ?
Ce n’est pas tout à fait du même ordre, mais il y a l’exemple de Ken le survivant [Hokuto no Ken], diffusé initialement au Club Dorothée à la fin des années 1980. Au bout de quelques épisodes, les gens se sont rendu compte que c’était assez violent et ça a fait scandale, avec des pétitions… L’animation japonaise n’avait déjà pas bonne presse dans les années 1980. Par la suite, il y a eu de la censure, parfois extrêmement lourde.
Cette série est entrée dans les annales pour son doublage « décalé ». Elle était tellement violente que les comédiens Maurice Sarfati (disparu récemment) et Philippe Ogouz ont exigé qu’on leur laisse les mains libres. C’était les années 1980, une autre époque. Ils ont complètement désamorcé cette violence en faisant des blagues. C’est devenu assez ridicule, avec des méchants qui parlaient par le nez et avaient des voix de fausset. Sans oublier les calembours du style « Nanto de vison » et autres « Hokuto de cuisine »… Du coup, ça fait beaucoup rire et pour une partie des gens, c’est un peu une madeleine de Proust, ce genre de doublage ! On pourrait réfléchir à la question du respect de l’œuvre, mais c’est du passé maintenant.
Les 20 derniers épisodes sont longtemps restés inédits et non doublés. Il y a quelques années, un éditeur a souhaité faire une édition DVD doublée d’une diffusion télé [sur la chaîne Mangas, qui appartient au groupe AB]. Il fallait donc compléter le doublage, mais la tâche était délicate : on voulait plus de sérieux, tout en respectant l’esprit des années 1980. Il y avait par exemple un méchant qui s’appelait Raoh en VO et Raoul en français. Un grand méchant qui s’appelle Raoul, c’était peu crédible… Le nom a tout de même été conservé par souci de cohérence et des voix ressemblantes ont été engagées. En revanche, l’adaptation était plus proche de l’esprit original, sans jeux de mots stupides, en respectant les moments de tension, etc. Un véritable exercice d’équilibriste. Je ne sais pas ce que ça a donné, je n’ai malheureusement pas eu le temps de m’y intéresser de plus près et de voir l’intégralité du résultat.
Comment était faite la traduction des anime de notre enfance ? Il devait être encore plus difficile qu’aujourd’hui de trouver des adaptateurs.
C’est la grande question, il y a un vrai travail de recherche à faire sur le sujet ! Les auteurs qui ont travaillé sur ces œuvres dans les années 1970-1980, s’ils avaient 30-40 ans à l’époque, en ont peut-être 70-80 aujourd’hui, il faudrait les interviewer.
Prenons Goldorak [UFO Robo Grendizer], l’une des premières séries qui s’affirmaient en tant que japonaises, avec une vraie rupture d’image. À l’époque, je suppose que pour un adaptateur comme Michel Gatineau et pour le monde du doublage en général, cette série était un autre monde. La légende veut qu’elle ait été choisie parce que les bobines à rapporter du Japon étaient moins lourdes que celles d’une autre série. Il y a une part de mythe autour de Goldorak… Évidemment, elle a été adaptée sur bande-mère, au papier et au crayon, à une époque où les gens avaient le temps de travailler. On ne faisait pas un épisode en trois jours, j’imagine.
Je ne pense pas que Michel Gatineau connaissait le japonais. Quelqu’un a dû réaliser une transcription, peut-être une traduction relais en anglais, et après, il y a eu un vrai travail d’auteur. Il y a des pépites d’adaptation dans la version française de Goldorak. C’est souvent assez éloigné du japonais, mais le texte « vit » vraiment et ça fonctionne, paradoxalement. Outre l’effet « nostalgie », il y a une vraie poésie dans les dialogues. On a l’impression que l’adaptateur s’est vraiment approprié la série. Il ne comprend pas forcément tout, mais il essaie d’en faire quelque chose, c’est assez marrant.
Nolife
Pour terminer sur votre parcours et arriver jusqu’à aujourd’hui, vous êtes resté environ quatre ans chez Toei Animation…
En 2007, une petite chaîne de télévision a vu le jour, Nolife, lancée de manière totalement indépendante par Sébastien Ruchet et Alexandre Pilot. Quand j’étais free-lance, j’avais travaillé un peu avec Alex, fait de l’interprétation pour lui. Ce sont des gens que je croisais aussi dans les conventions de japanim, à Japan Expo, etc. Je donnais parfois un coup de main à des gens de la chaîne parce que j’adorais le projet. En mai 2012, ils ont cherché un journaliste pour assurer notamment les news consacrées au jeu vidéo dans le cadre d’une quotidienne intitulée 101 %, diffusée chaque soir à 19 h. Il leur fallait quelqu’un qui soit à la fois journaliste mais en même temps un peu chargé de production pour organiser les plannings d’enregistrement des voix, et un japonisant, vu les thématiques de la chaîne. Ça faisait très longtemps qu’on se côtoyait, c’était l’occasion. J’ai franchi le pas sans hésiter. Je continue à faire un peu d’adaptation en free-lance, notamment pour One Piece, sur mon temps libre le week-end.

Quelle est la place du japonais sur Nolife ?
Elle est très importante. Sébastien Ruchet a beaucoup travaillé par le passé pour le magazine AnimeLand à ses débuts et Alexandre Pilot est résolument ancré dans le Japon et dans le japonais. Il y a aussi Suzuka qui s’occupe des relations avec le Japon. Nolife est à la base une chaîne musicale et ses premiers programmes étaient des clips de musique japonaise.
On diffuse des anime exclusivement en version originale sous-titrée. C’est un vrai choix éditorial : un diffuseur qui cherche à faire de l’audience ne diffuse pas ses séries en VOST, ça ferait fuir 90 % des spectateurs. Comme c’est une chaîne de niche, elle opte pour des séries qui ne seraient pas diffusables ailleurs ou qui vont intéresser un public particulier, comme Nadia, le secret de l’Eau Bleue [Fushigi no umi no Nadia] ou Gunbuster [Top wo nerae], qui a un certain âge, mais a toujours un vrai potentiel. Ou encore Noir [Nowāru], plus destinée à un public adulte, puisque c’est l’histoire de deux tueuses à gages qui affrontent une société secrète.
On a en outre des partenaires japonais qui produisent des émissions au Japon pour Nolife, parce que c’est un plus pour eux d’avoir une diffusion française : Japan in motion, une hebdomadaire, et le magazine Esprit Japon. Il y a de vrais moyens de production, des images de qualité… c’est un petit morceau de télé japonaise qui atterrit directement sur Nolife. C’est produit principalement au Japon, mais la voix off est enregistrée en France. La force de Nolife, c’est ainsi d’offrir une porte d’entrée pour les contenus japonais en France, alors que nos interlocuteurs ne savent pas toujours comment s’y prendre pour les distribuer ici.
Simulcast
En parlant de distribution, avez-vous eu l’occasion de travailler pour du simulcast2? Que savez-vous de ce mode de diffusion ?
Je n’ai pas du tout eu l’occasion d’en faire. On m’en a proposé, mais ça se fait dans des créneaux horaires très restreints, car le Japon ne fournit aucun élément (vidéo, script…) avant la diffusion japonaise, ou très peu3, pour des raisons de sécurité. C’est compliqué : il faut des années, voire des décennies pour établir une relation de confiance. C’est aussi un secteur qui évolue très rapidement.
Les adaptateurs qui travaillent en vue de diffusions J + 1 ont peut-être la vidéo un jour avant la diffusion dans certains cas malgré tout. Mais régulièrement, ce qu’on appelle « simulcast » désigne une diffusion une semaine après le Japon. Le temps de recevoir les éléments, de les préparer pour le traducteur, de faire le repérage, puis deux ou trois jours pour réaliser l’adaptation, et encore un peu de marge pour l’encodage avant de pouvoir mettre l’épisode en ligne.
C’est un modèle qui se développe beaucoup ? Est-il viable ?
Il y a plusieurs plateformes accessibles en France, comme Crunchyroll, Wakanim, ou encore Anime Digital Network. À la télévision, seules quelques séries sont diffusées en simulcast. Sur les plateformes de VOD ou de streaming, en revanche, il y en a dix par site, l’offre est donc très fournie. Les spectateurs peuvent visionner chaque semaine 30 épisodes de dessins animés japonais, avec une semaine de décalage avec le Japon. Ce sont vraiment des nouveautés très fraîches, sans le filtre d’un éditeur qui mise sur le succès de telle ou telle série : là, on a tout d’un bloc.
Je ne connais pas les conditions de travail pour chaque plateforme, mais les tarifs qu’on m’avait proposés semblaient dans la fourchette normale d’une adaptation de dessin animé japonais classique, soit entre 300 et 400 euros pour un épisode de 25 minutes, pour le repérage et l’adaptation.
Si le simulcast se maintient pour l’instant, c’est parce que c’est un marché de niche. Même si ce n’est pas une masse énorme, il y a un public très fidèle pour ce genre d’initiatives. Un site comme Wakanim, par exemple, a d’abord diffusé en simulcast une série très à la mode comme L’Attaque des titans [Shingeki no Kyojin], qui a eu suffisamment de succès pour qu’une version doublée soit réalisée et diffusée sur France 4. C’est donc un beau succès anime en France. Cette plateforme-là a été rachetée par Sony via sa filiale Aniplex, qui profite donc de ce site bien établi pour s’implanter en France.

Cela nous amène sur le terrain du fansubbing, auquel est liée l’apparition du simulcast et qui s’est historiquement développé d’abord pour l’animation japonaise.
Tout à fait. On trouve d’ailleurs sur le Net un petit documentaire bien fait sur la dynamique initiale4 du fansubbing d’anime. En France, les personnes qui allaient au Japon pour se procurer les premières VHS dans les années 1980 sont pour beaucoup devenues éditeurs de mangas ou de dessins animés, aujourd’hui. À l’époque, chaque magazine japonais, chaque anime qui atterrissait entre les mains de quelqu’un était un trésor. Les communautés de fans se regroupaient facilement pour regarder un laser-disc ensemble. Par des groupes de discussion aux débuts d’Internet, certains arrivaient à récupérer une transcription en anglais et faisaient eux-mêmes une traduction.
Durant mes études, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, quand il commençait à être plus facile de se procurer ce genre de matériel, j’ai vu tout ça de près à quelques occasions. Il m’est aussi arrivé de sous-titrer quelques courts métrages d’animation pour un ami qui voulait les comprendre.
Il y a deux idées très présentes dans le fansubbing, de ce que je connais. D’abord, les fansubbers ont le sentiment de faire le travail de l’éditeur à sa place. « Regardez cette belle série, heureusement que je suis là pour vous la faire découvrir, sinon vous seriez passés à côté. » C’était peut-être vrai dans les années 1980, mais plus de nos jours… Et ensuite, l’argument qui veut que le fansubbing ne soit pas interdit et soit donc toléré, ce qui ne tient pas la route juridiquement. Avec le développement des plateformes, où on a accès à une offre très riche pour quelques euros par mois, il est devenu facile de voir des dessins animés japonais légalement, soit en simulcast, soit en attendant quelques mois. La qualité des sous-titres est peut-être variable, je ne suis pas allé voir partout, mais pour ce que je connais, c’est très correct dans l’ensemble. L’argument, parfois avancé, des sous-titres de meilleure qualité par les fans ne tient pas la route, sauf si on considère des couleurs flashy partout et des karaokés qui envahissent l’écran comme un gage de qualité. Il reste certainement des séries des années 1980 qui n’ont jamais été éditées en France parce que les droits sont bloqués (ou d’autres cas de figure), mais ça ne court pas les rues. La plupart des fansubs que l’on voit sur le net, c’est la « Team Naruto X » qui présente le dernier épisode de Naruto avant la « Team Naruto Y », c’est pour beaucoup un concours de vitesse.
Pour autant, je ne crois pas qu’il y ait moins de fansubbing d’anime qu’à une époque. Le modèle de fans se perpétue. Ce sont souvent des petites équipes de quelques personnes qui se renouvèlent facilement quand l’un des fans a envie d’arrêter.
Adaptation au public
L’une des caractéristiques du fansubbing d’anime, c’est son côté très sourcier5: laisser « san » au lieu d’écrire « monsieur », « katana » au lieu de « sabre » ou « épée »… Quand on traduit, est-ce qu’on pense aux spectateurs qui ne connaissent rien de la culture japonaise ?
Ah oui, le fameux côté « magique » de la langue… Il y a évidemment un équilibre à trouver, d’autant qu’une évolution a eu lieu dans le public, qu’il faut prendre en compte. On peut commencer par évacuer le ridicule qu’il y a à laisser certaines expressions que peu de gens comprendront telles quelles, comme « Arigatô » (merci) ou « Yoroshiku onegaishimasu » (qui peut se traduire de multiples manières dont « je vous en prie »). Pour le reste, c’est vraiment une question de ligne éditoriale. Souvent, l’adaptateur est un peu livré à lui-même devant sa série animée. Quand il tombe sur des éléments typiquement japonais dans l’épisode qu’il adapte, il n’a qu’une angoisse, c’est qu’il y ait de nombreux retours du client du style : « Tu as mis “yen”, je voulais “euro”, tu as mis “tonkatsu”, je voulais “porc pané”… » S’il a trois jours pour adapter un épisode et que ce n’est pas à lui de définir ce genre de choses, il va être un peu perdu. Il faut qu’il y ait un interlocuteur qui comprenne la problématique et qui prenne ces décisions.
On peut avoir des demandes particulières pour les tout-petits, sur des chaînes jeunesse. Il faut alors que l’adaptation soit très accessible. Dans le cas d’une série qui n’est pas localisée très précisément au Japon, les quelques traits japonais peuvent être camouflés sans que cela porte atteinte à l’âme de la série. Dans ce cas, on écrira « boulettes de riz » plutôt qu’« onigiri ».
Si c’est une série clairement japonaise qui se passe dans un cadre japonais, elle va a priori s’adresser à un public qui, même s’il ne connaît pas la culture à fond, est attiré par l’univers nippon et ne va pas tomber des nues en découvrant que ça se passe au Japon. Mais il reste des questions tangentes : à quel point certaines réalités japonaises ont-elles été absorbées, assimilées par le public français ? Dans une scène qui se passe dans une gare, est-ce qu’on va écrire que les personnages prennent le « Shinkansen » ou le TGV ? Sans compter que « TGV » est plus court pour un sous-titrage ! Lors d’une scène dans un restaurant, il y aura forcément des noms de recettes de cuisine japonaise partout : jusqu’où aller ? La cuisine japonaise est extrêmement complexe. Ça me rappelle un manga intitulé Les Gouttes de Dieu6 [Kami no Shizuku], une histoire d’œnologue. Chaque vin qu’il goûte lui rappelle une région hyper précise en France, les descriptions sont extrêmement techniques. On peut imaginer la même chose pour le saké ! Ne serait-ce que le ferment « koji » utilisé pour confectionner le saké : est-ce qu’on traduit le mot ? Est-ce qu’on explique une bonne fois pour toutes que c’est le ferment essentiel à la fabrication du saké, pour l’intégrer dans le vocabulaire de base de la série ?
C’est souvent une question de bon sens, au cas par cas : pour tel mot, je pense que les gens ne vont pas comprendre et que ça porte atteinte à la compréhension directe, immédiate, de la série. Pour tel autre, il me semble que les spectateurs peuvent au contraire comprendre cette réalité… Beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte, il n’y a pas de solution toute faite.
Autre question sur la différence de public : certaines séries comme Albator étaient plutôt destinées aux adolescents, initialement, mais pour la diffusion française, on en a fait un produit pour enfants. Avez-vous été confronté à des demandes pour édulcorer des séries animées ?
Les problèmes de « cibles » concernent surtout les gens qui veulent vendre les séries. Il y a souvent une incompréhension éditoriale entre ceux qui cèdent et ceux qui acquièrent les droits sur les séries : un programme présenté comme « pour les 6-10 ans » sur les plaquettes publicitaires japonaises va s’avérer en réalité être plutôt pour adolescents. Cela tient entre autres aux rapports qu’ont les deux cultures avec l’image.

Au Japon, les mangas Dragonball, One Piece ou Hokuto no Ken ont été publiés dans le magazine Shōnen Jump, c’est-à-dire pour un public qui va des jeunes garçons aux lycéens. Certains lecteurs qui ont grandi avec Jump pourront continuer à le lire même à 25 ans, ces histoires peuvent s’adresser à plusieurs générations, mais fondamentalement, le public visé, c’est le jeune garçon ou le pré-ado, qui va lire une histoire initiatique montrant comment on peut surmonter des épreuves, à force de résistance et de persévérance. En France, aujourd’hui encore, l’archétype du dessin animé pour enfants a la vie dure. Il est compliqué de faire comprendre qu’il peut y avoir des dessins animés qui s’adressent à différents publics.
De plus, une scène qui va choquer au Japon ne va pas forcément choquer en France, et inversement. L’humour pipi-caca, qui paraît très innocent au Japon et va passer sans problème sur une chaîne à une heure de grande écoute, sera sans doute moins bien accepté en France. La série Naruto, elle, a été diffusée quelque temps dans la case jeunesse de France 3, mais dans une version censurée, car elle paraissait trop violente. Pour rappel, ce sont des histoires de ninjas qui s’affrontent en permanence. Les chaînes Game One puis J-One ont d’ailleurs fait de la promo en annonçant qu’elles allaient diffuser Naruto en intégralité, non censurée. De nos jours, ce genre de diffusions se réfugie vers le câble et le satellite, où il peut y avoir plus de liberté. Il y a en général moins de pressions et de demandes éditoriales, si ce n’est éviter trop de gros mots dans l’adaptation.
Qu’en est-il des niveaux de langue ?
En matière d’injures, je trouve le français beaucoup plus fleuri que le japonais, qui est souvent moins inventif. En japonais, on utilise beaucoup plus le registre de langue, le ton… Ou simplement la déformation de certains mots. Par exemple, « anata » veut dire « toi », c’est un terme neutre. Si on dit à la place « témaé », c’est déjà plus familier et si on passe à « téméé », c’est insultant. Si en plus on roule les « r » et qu’on ajoute quelques « yaro »… C’est un terme d’argot qui désigne un connard, une enflure, que l’on retrouve par exemple souvent dans les films de Kitano. Il faut trouver quelque chose en français pour faire passer ça, mais dans certaines limites. On veut bien que ce soit intense, mais pas forcément que ça verse dans l’insulte ordurière. Il peut donc y avoir une certaine édulcoration, mais pas vraiment de pressions ou de censure bête et méchante.
Il peut y avoir des variations subtiles de niveau de langue n japonais : une femme ne va plus s’adresser de la même manière à son conjoint avant et après leur mariage. Par exemple, une fois mariée, elle utilisera systématiquement le terme « anata » à l’intention de son mari. Si elle l’appelait « Yamada-san » auparavant, elle l’appellera « anata » après le mariage. Cela peut être aussi un indice dans un film qu’il y a eu un mariage sans que le spectateur en ait été témoin… Ça pose évidemment un problème si on pense au filtre que représente une éventuelle traduction relais en anglais. Et en français, c’est par d’autres moyens qu’on va réintroduire la familiarité ou la distance, peut-être à un autre endroit dans les dialogues.
Un autre problème peut se poser : le japonais est une langue qui peut être très concise, mais plus elle est polie, plus elle se dilate. Et souvent, en plus, on n’a la proposition principale qu’à la fin. Donc toutes les subordonnées sont en début de phrase (de temps, de manière…) et à la fin, une proposition vient changer tout le sens. Il faut donc tordre l’adaptation dans l’autre sens.
De quelques particularités du japonais
Y a-t-il d’autres difficultés propres au rythme de la langue ?
En dessin animé, les Japonais ont tendance à privilégier le jeu à la synchro, sauf dans les longs métrages ou les grosses productions pour lesquels la synchro est très travaillée. Dans une série classique, il y a trois bouches dessinées : position ouverte, fermée et intermédiaire. La position ouverte va parfois être un peu accentuée pour marquer une exclamation dans la synchro, mais c’est tout. On calcule la longueur du dialogue et on enchaîne les trois positions, de façon un peu aléatoire, à l’animation.
J’ai travaillé par exemple sur Ghost in the Shell : Stand Alone Complex [Kōkaku Kidōtai : Stand Alone Complex], une série cyberpunk très bavarde, avec beaucoup d’explications philosophiques souvent assez obscures. Il y avait parfois des phrases de 20 ou 25 secondes sur lesquelles l’animation était homogène, avec ces ouvertures de bouche aléatoires. En japonais, la comédienne est dans son jeu : sur ces 25 secondes, elle va faire trois phrases, marquer un accent au milieu, prendre deux secondes de pause en cours de route, et ça ne sera pas grave que les lèvres du personnage continuent à bouger. Avec la mise en scène, ça passe. Si on fait la même chose en France, n’importe quel spectateur va se dire : « Qu’est-ce que c’est que ce travail de cochon ? » Il faut donc faire durer la phrase 25 secondes, même si c’est tiré par les cheveux et même si le contenu tiendrait en 10 secondes. On essaie de délayer, de faire en sorte que ce ne soit pas trop lourd, d’introduire une mini-pause quand même…

On sait aussi que le japonais est une langue pleine d’ambiguïtés qui peut donner du fil à retordre aux traducteurs.
C’est une langue qui est beaucoup dans le sous-entendu. Le sujet d’une phrase n’est souvent pas explicité grammaticalement. Sans compter que c’est une langue riche en homophonies !
Ce qui peut être compliqué, c’est que parfois, l’ambiguïté est voulue dans la version originale. Imaginons qu’on parle d’un meurtrier mystérieux, une personne X. Les enquêteurs peuvent en parler en disant « la personne X va faire ceci ou cela ». En japonais, ils vont pouvoir rester dans le flou pendant très longtemps, sans préciser par exemple le genre de cette personne. Le renversement ou la révélation peut arriver bien plus tard. En français, on est obligé de faire un choix. On ne va pas passer 15 épisodes à faire des tournures emberlificotées pour essayer de ne pas employer un pronom personnel…
Il y a un « cliffhanger » typique dans les anime japonais : un personnage se retourne en s’exclamant « Anata ga… », c’est-à-dire « Tu es… ». La phrase reste en suspens, il y a un changement de plan et on passe à une autre partie de l’intrigue. En général, comme on a vu avant le personnage crocheter une serrure ou quelque chose de cet ordre, le sous-entendu est clair : « Mon Dieu, c’est toi le coupable ! » C’est au spectateur de compléter par lui-même selon le contexte. En doublage, si le personnage est à l’écran, on a à peu près trois battements pour faire une phrase complète, c’est un problème. Évidemment, on va éviter le classique « Oh, tu es ! », très idiomatique… (rires) Le comédien serait ravi ! Il faut donc trouver une manière de compléter la phrase, de tourner ça d’une façon ou d’une autre.
Dans des cas comme ça, le côté très elliptique du japonais peut être compliqué.
Y a-t-il des références culturelles très actuelles ou au contraire très anciennes qui peuvent donner du fil à retordre aux adaptateurs ? En particulier pour les auteurs de doublage qui adaptent à partir d’une traduction relais, sans parler le japonais…
Il y a de tout, ça dépend des séries. Quand on parle d’anime, on pense spontanément à des séries comme Dragonball, où les personnages se bombardent de boules de feu. Là, il y a peu de chance qu’il y ait des références à un fait divers réel récent, par exemple. Mais c’est complètement différent dans une série comme Terror in Resonance qui date de 2014. C’est une intrigue très géopolitique et actuelle sur deux dissidents qui prévoient de faire un attentat nucléaire dans Tokyo. Il y a une dizaine d’épisodes, c’est une très bonne série. Là, la probabilité qu’il y ait des références plus contemporaines augmente.

On se débrouille comme on peut. Avec le Net et les réseaux sociaux, on est nettement moins désemparé qu’il y a ne serait-ce que dix ans. Il existe des forums de voyageurs au Japon ou de fans du Japon : si vraiment on est bloqué par une phrase et qu’on ne parle pas japonais, on peut fouiller sur Internet et finir par trouver quelqu’un qui va donner une explication, un avis, etc.
On croise peu de vieux kanji7 dans les anime, en revanche. Les kanji sont l’écriture des lettrés, importée de Chine. Au Japon, une personne très cultivée et qui a beaucoup lu connaîtra beaucoup plus de kanji qu’un Japonais lambda qui lit simplement le journal et qui a une éducation moyenne. Il est rare que cette dimension puisse poser problème en animation. On peut imaginer, dans une série qui se passe à l’époque féodale, que le dialoguiste fasse quelques recherches et utilise un vieux kanji pour donner un cachet classique à une réplique, mais c’est tout.
Ce qui peut être déstabilisant, c’est au contraire certains termes très actuels. Certains mots, comme « otaku », ont été importés et sont très utilisés en français. Du coup, même au Japon, aujourd’hui, cela désigne un fan d’animation japonaise qui ne sort jamais de chez lui. Mais initialement, « otaku » est un terme de politesse qui signifie « ta maison ». On peut donc trouver le mot « otaku » dans un discours un peu formel, ça ne voudra pas dire qu’on parle d’un geek fan de dessins animés.
Le japonais a aussi la capacité de créer des néologismes très facilement. Par exemple, les célèbres Pokémon, abréviation de « Pocket Monster », ou cosplay, pour « Costume Playing », qui désigne l’activité des fans qui se déguisent en leur héros fictif préféré.
Il y a aussi « netabare ». « Neta », c’est une astuce, un truc. Dans un film à rebondissements, il y a une « neta » à la fin. Ou quand on parle de comiques qui ont plein de petites histoires drôles, d’astuces dans leur répertoire, on dit qu’ils ont des « neta ». Et « bare », « bareru », veut dire « être découvert, être mis au jour ». Donc quand tu dis que tu as donné à quelqu’un un « netabare », en fait, c’est que tu as fait un spoiler [en bon français, révélé un élément clé de l’intrigue d’un film ou d’une série ].
Grâce au système des katakana, la langue japonaise a une capacité d’absorption des mots étrangers très importante et une flexibilité extrême. Les Japonais peuvent créer des néologismes tout le temps, ils restent compréhensibles et les structures de base de la langue demeurent très solides. La création de mots va très vite, surtout chez les jeunes. Quand on traduit, on est obligé de décomposer le terme pour le comprendre et ce sont bien sûr des mots qui peuvent avoir une vie éphémère et qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires. Il faut faire des recherches sur Internet ou fouiller des forums pour voir d’où ça vient.
Y a-t-il des particularités régionales ?
Oui, il y a une langue standard mais aussi des régionalismes très importants, des patois, qui peuvent être assez différents. Ils sont parfois utilisés dans l’animation. En général, ça reste assez léger, pour pouvoir être compris par tout le monde, mais c’est le meilleur moyen de caractériser un personnage. Le plouc qui vient de sa campagne, par exemple, va s’exprimer dans son patois.
Pour la version française, c’est l’éternel problème des accents. Il peut arriver qu’un comédien propose une caractérisation, un accent… Mais il est possible que le directeur artistique passe complètement à côté. Quand j’étais chez Toei Animation, il m’arrivait de signaler ce genre de choses au directeur artistique, qui réfléchissait alors à la manière la plus naturelle d’intégrer cette dimension sans verser dans quelque chose de surjoué et artificiel.
Dans One Piece, je me souviens d’un personnage très difficile à adapter : l’agent secret Kumadori, qui est un guerrier acteur de kabuki. Il surjouait toutes ses répliques. C’était excellent en japonais, il avait un parler à la fois classique et un peu théâtral. Mais essayer de faire du kabuki à la française, c’était compliqué ! À part lui donner un ton pompeux sur certaines répliques et adapter un peu le registre, il n’y avait pas grand-chose à pouvoir faire.
C’est aussi le genre de chose qui risque de passer à la trappe si l’on passe par une traduction relais. Sauf si le script anglais est bien fait : parfois, les intentions et les registres sont signalés. Mais quand on se retrouve dans le pire des cas avec des sous-titres italiens ou allemands et qu’on n’a que ses oreilles pour faire la détection, c’est très compliqué. Même s’il y a nécessairement des pertes quand on passe par l’anglais, avec un minimum de sérieux à tous les échelons, il y a moyen de sécuriser un peu le processus pour que le résultat ne soit pas catastrophique.
Avantages et inconvénients d’une niche
On s’imagine que les traducteurs du japonais spécialisés dans l’audiovisuel forment un peu une niche à l’intérieur d’une niche, est-ce le cas ?
J’ai noté une particularité en France : en sous-titrage, les traducteurs travaillent surtout directement du japonais vers le français. C’est notamment le cas de ceux qui font du simulcast. Ils n’ont pas le temps de perdre deux jours pour avoir une traduction relais… Au contraire, en doublage, la majorité des auteurs sont des non-japonisants. Ça tient peut-être à la spécificité du doublage, à la contrainte de synchronisme, bien qu’elle soit plus légère pour l’animation, je ne sais pas…
J’étais le premier japonisant à faire le DESS de Nanterre – et j’imagine, plus ou moins le premier en France à suivre une formation spécialisée en traduction audiovisuelle. Depuis, il y a eu quelques étudiants dans le même cas à Nanterre. Il y a aussi pas mal d’autodidactes, ou encore des binômes entre un traducteur de langue française et un(e) Japonais(e).
En tout cas, c’est un plus de parler japonais dans la masse d’auteurs de doublage. Quand j’étais indépendant, c’est ce qui m’a permis de travailler pendant trois ans sans jamais avoir plus d’une semaine de creux, alors que certains de mes confrères sur le même créneau que moi, mais non japonisants, avaient des périodes de vache maigre plus longues.
Il faut aussi être ouvert à toutes les opportunités, ne pas se dire qu’on ne va faire que du doublage de dessins animés japonais : sous-titrage, interprétation si on peut, simulcast, mangas, traductions de livrets, DVD bonus… On peut faire un peu de tout.
Vous avez des projets pour l’avenir ?
Actuellement, je travaille à plein temps chez Nolife et je fais un peu d’adaptation de temps en temps. Je suis content de mon sort parce que dans mon parcours, je n’ai jamais vraiment réfléchi à un « plan de carrière » précis, mais j’ai toujours réussi à m’en sortir et à faire ce qui me plaisait. J’ai fait des choix que je ne regrette pas du tout et je me sens privilégié d’exercer un métier que j’aime plutôt qu’une activité qui me rendrait malheureux mais qui m’offrirait des conditions matérielles plus confortables.
Je ne sais pas ce que me réserve l’avenir. Rien n’est gravé dans le marbre, tout peut changer très vite, surtout quand on travaille dans un secteur assez précaire. Pour l’instant, tout se passe bien et je continue à avoir du japonais dans les oreilles tous les jours, à lire des mails et autres documents en japonais, à chercher des infos pour des reportages… Lors des interviews avec des Japonais que je réalise pour Nolife, je peux aussi me passer d’interprète, ce qui fait gagner la moitié du temps pour l’entretien. C’est un gros point en plus et ça me permet d’être tout le temps en contact avec le Japon.
Propos recueillis par Samuel Bréan et Anne-Lise Weidmann à Paris, le 28 juillet 2015
Entretien révisé par Emmanuel Pettini en août 2016
